Misérabilisme et devoir de mémoire ?
Exception faite de Balzac ou Zola, il semblerait que le misérabilisme ne produit pas de gros pavés. Par ailleurs, avec la télévision qui vomit à tour d’antenne des horreurs vraies aux actualités ou mises en scène dans les séries, nous sommes devenus insensibles au malheur des autres tant qu’il reste éloigné derrière l’écran ou dissimulé dans les pages d’un livre. Tout comme au XIXe siècle, une incontestable délectation à se repaître des conditions de vie sordides de certains de nos frères humains semble exister. Cette disposition donne naissance à un nouveau terme qui cache une activité loin d’être récente : le tourisme noir – forme de tourisme qui, selon Salvayre, serait propédeutique[1] –, aussi appelé le tourisme de catastrophe, le tourisme sombre, tourisme macabre ou le thanatourisme qui a son tour engendre des petits livres loin des gestes balzaciennes.
Lydie Salvayre, avec son roman précurseur, Les belles âmes[2], arrivait à peine à remplir 140 pages ; Le Wagon d’Arnaud Rykner[3] n’en comportait pas plus d’une centaine et Chris Simon en noircit tout juste 130 avec Memorial Tour[4].
Dans Le Wagon – loin d’être un pavé comme nous l’avons souligné –, un narrateur prend la place d’un déporté pendant les trois jours d’un voyage interminable vers une destination inconnue, mais dont il y a tout lieu de croire qu’elle est celle d’un camp de la mort. L’embarquement cruel d’hommes, femmes et enfants interpelle le narrateur :
Lequel aurait pensé pourtant qu’on entasserait cent corps dans ce wagon prévu pour “quarante hommes ou huit chevaux en large” ? Et cent corps dans le wagon devant. Et cent corps dans le wagon derrière. Et vingt wagons, ou plus, pour aller où ? Vingt wagons à la queue leu leu, comme des enfants punis, des enfants honteux, morveux, battus, sales, retenant leur culotte, se retenant pour ne pas souiller leur culotte.[5]
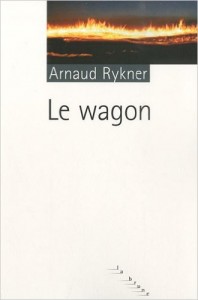 Avec pudeur et compassion, Rykner reproduit un train de pensée qui, s’il étonne parfois, fait montre de cohérence et de réflexion, réflexion de celui au bord du gouffre qui résiste pour éviter d’y sombrer :
Avec pudeur et compassion, Rykner reproduit un train de pensée qui, s’il étonne parfois, fait montre de cohérence et de réflexion, réflexion de celui au bord du gouffre qui résiste pour éviter d’y sombrer :
Il nous reste encore ça. Cette force de pouvoir rire d’eux, au bord de s’évanouir, bientôt peut-être au bord de la tombe. Mais, c’est notre tour de nous lever. Fin de la parenthèse. Je me demande si j’aurai encore l’occasion de rire. Nos visages à présent se figent. Seule notre bouche s’ouvre, excessivement. Comme un plongeur qui sortirait de l’eau. De l’eau. Cette seule idée me fait mal tant j’ai soif. Il faudrait ne plus penser. À rien. N’être plus rien. Je voudrais être mort. Je suis fatigué.[6]
Le héros – peut-on encore parler de héros dans le cas d’un corps pressé jusqu’à l’étouffement – sans le vouloir, comme envahi par une mémoire involontaire, bénéficie du voyage forcé pour réfléchir sur des questions existentielles auxquelles il n’aurait peut-être, sans cela, jamais été confronté :
Contrairement à ce que je pensais, la mort des autres m’est plus atroce que la mienne. Parce qu’elle est pire que ma mort, qui n’est qu’une idée de ma mort, alors que la mort des autres c’est ma mort vécue, c’est ma mort au présent, regardée, écoutée, auscultée avec horreur.[7]
Horreur de l’acheminement accentuée par la chaleur, le manque criant de provisions de bouche et la totale absence d’eau. Impossible de rester raisonnable dans ces conditions et chaque tentative de relativiser ou d’analyser à voix haute la situation devient un sujet d’hystérie collective. Il en est ainsi lorsque l’un d’entre eux essaie d’expliquer le processus chimique à l’œuvre dans le pourrissement de la paille étalée en litière dont s’échappent des vapeurs nocives :
Alors, comme s’ils n’avaient attendu que ça pour se réveiller, comme si la conscience soudain leur était redonnée par ces mots leur annonçant une mort idiote, abjecte, sous le soleil, tous les camarades se mettent à hurler, à frapper les parois, des pieds, des mains, certains de la tête, criant qu’on nous ouvre, qu’on nous donne de l’air, qu’on ne nous laisse pas crever comme des bêtes, qu’on ne ferait même pas ça à des bêtes. Ils crient, ils tapent, ils hurlent. Les pieds hurlent autant que les têtes.[8]
Le narrateur reporte avec minutie l’enfer du voyage. Le tas de cadavres empilés, des morts succombés dès le premier jour de douleur où il essaie d’échapper à leur vue impressionnante et annonciatrice d’une fin éventuelle prochaine.
Moi, je me suis mis une chemise sur la tête, et je respire au travers, sans rien voir. Mais rien ne m’empêchera d’entendre le gargouillement qui sort de la masse informe. On peut se cacher les yeux, se boucher le nez, mais nos oreilles nous rattrapent. Avec elles on ne peut rien faire, on ne peut pas tricher. Elles nous livrent à eux. À cause d’elles, les morts continuent de nous parler, de gémir dans leur langage à eux, fait de bouillonnements sourds, lugubres, obstinés.[9]

La libération ne viendra pas ; le lecteur le sait dès la première page, la première ligne où il a encore le choix. Continuer la lecture ou poser le livre. Que peut-il apprendre de cette introspection, cette descente dans les tréfonds de l’horreur ? Peut-être justement est-ce de sentir ce que la déportation a pu être pour la part de l’humanité qui l’a subie sans jamais se départir de son savoir, de la connaissance de son bourreau : l’homme embrigadé dans une spirale de haine où même les enfants avaient leur place dans le processus de destruction :
Avant que je comprenne, un caillou cogne le barbelé puis m’atteint en pleine joue. Je me baisse d’instinct avant de comprendre que c’est un groupe d’enfants qui me regardent ; ils profitent d’un court arrêt du train pour lapider les ennemis de l’Allemagne. J’entends leur cri, je l’entends sans y croire : “Juden ! Juden ! Alle ins Krematorium”.[10]
Savaient-ils donc la destination finale des Juifs transportés dans les trains sur les rails si près d’eux ? Comment des enfants pouvaient-ils souhaiter la mort de leurs semblables ? Il est probable que ce soit cela le véritable Mal, lorsque les enfants reprennent à leur compte les plus vils concepts des adultes et ne reconnaissent plus des membres de l’humanité comme les leurs.

Tourisme noir
Une référence à Balzac et Zola est loin d’être tout à fait fortuite, le XIXe siècle ayant été généreux en compositions décrivant les nantis visitant les damnés de la terre occidentale et faisant œuvre de charité ou les scènes peignant de façon pittoresque, dans des romans-fleuves, la vie des gens misérables – principalement comparée à celles de ceux qui pouvaient se permettre de les lire. Que l’on songe à Mérimée, Dumas ou Hugo. Toutefois, personne ne parlait de tourisme noir à l’époque, le terme n’ayant pas encore fait son apparition. Les livres de Salvayre et Simon explorent le thème.
Lydie Salvayre met en scène un groupe d’hommes et de femmes embarqués dans un tour des quartiers pauvres des banlieues des grandes villes européennes avec un guide pour le moins grandiloquent :
Cette cité, dit-il, bouleversé, cette cité ressemble à une prison. Son architecture froide, sa tristesse infinie, ses fenêtres fermées sur ce ciel glauque la font pareille à une prison. Et c’est ce qu’elle est en vérité. Une prison sans geôlier où l’on parque le troupeau des hommes humiliés. Et ces hommes, dit-il, parqués à perpète dans ces immondes tours, mourront sans avoir rien connu de la beauté du monde et sans jamais l’avoir célébrée. Et leurs enfants, plongés jusqu’au cœur dans la laideur des choses mourront dans la laideur. Or il y a dans la laideur quelque chose qui fait peur, qui fait mal, qui mortifie les âmes et insulte atrocement l’intelligence. Quelque chose qui tue.[11]
Rencontres organisées avec les habitants et les belles âmes sont les touristes qui désirent connaître la vérité. Celle des quartiers les confronte à la pauvreté ambiante et même à l’absence d’accommodations publiques, un manque similaire se retrouve chez Simon et Rykner :
Mlle Faulkircher murmure, entortillée, à l’oreille de Jason qu’elle voudrait aller au petit coin. Mais nul édicule n’est prévu dans la cité à usage de petit coin, en dehors des ascenseurs et cages d’escaliers. Jason lui suggère de pisser derrière une bagnole. Les femmes feront la haie. Vu des fenêtres, le spectacle sera moins choquant qu’un combat de pitbulls. Hi hi hi ![12]
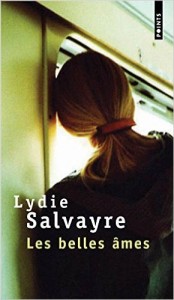 Après plusieurs visites de foyers décrépis, la beauté de leurs âmes s’effrite et c’est bien heureux qu’ils retournent dans leurs douillettes maisons, loin des misères pourtant si proches géographiquement. L’humour de l’auteur sauve le livre dont le lecteur s’interroge sur le besoin de ces visiteurs à déambuler au milieu de la pauvreté et des horreurs humaines comme le fait le chauffeur du bus Vulpius :
Après plusieurs visites de foyers décrépis, la beauté de leurs âmes s’effrite et c’est bien heureux qu’ils retournent dans leurs douillettes maisons, loin des misères pourtant si proches géographiquement. L’humour de l’auteur sauve le livre dont le lecteur s’interroge sur le besoin de ces visiteurs à déambuler au milieu de la pauvreté et des horreurs humaines comme le fait le chauffeur du bus Vulpius :
Le chauffeur Vulpius se demande, néanmoins, par quel désir contre nature, par quelle insane perversion ces touristes aisés qui pourraient, s’ils le voulaient, visiter de belles et grandes choses comme le Taj Mahal, le Krak des Chevaliers ou la pyramide de Kheops, le chauffeur Vulpius se demande par quel penchant morbide, par quelle aberration vicieuse ces touristes retors sont venus se paumer dans d’aussi mornes paysages. C’est louche.[13]
Le couple de Chris Simon pense avoir rendez-vous avec l’histoire. Pour eux, comme pour les excursionnistes de Lydie Salvayre, il s’agit d’un choix. Dans Memorial Tour, Patrice, veut faire un présent à sa femme qui discute tranquillement avec d’autres embarqués : « – Une surprise de mon mari. Il croit qu’il suffit de se mettre à la place des autres et vivre leur expérience pour les comprendre. Une sorte de religion chez lui. Moi, je suis plus pessimiste, mais toujours curieuse de connaître mes limites ! »[14]
Salvayre et Simon ont toutes les deux la psychiatrie en commun et plus exactement le lacanisme. Chris Simon en rapporte les séances dans sa série Lacan et la boîte de mouchoirs et Lydie Salvayre s’inspire de sa définition du fantasme pour préciser celui d’Olympe, la jeune amie de l’animateur.
Devant les réactions du groupe, l’accompagnateur n’est pas autrement surpris. Pour avoir participé par trois fois à de semblables pèlerinages, il sait que se succèdent quatre phases chacune marquée d’un pic : une phase d’enthousiasme humanitaire, une autre de dépression cyclonique de la conscience, suivie de près d’une phase purement catastrophique, qui précède, à l’arrivée, une phase de lâche soulagement. La séquence est algébrique.[15]
L’hésitation dans le choix du périple est décrite chez Salvayre et Simon. Les voyageurs de Rykner n’ont évidemment pas eu d’autre option.
Dans les romans de Salvayre et de Simon, tout le monde prend le début du circuit à la rigolade. Pour les touristes de Simon, il s’agit d’une simulation. « Historiquement correct » s’écrie l’un des gaillards. Cependant l’invraisemblable surgit dans Memorial Tour lorsque les voyageurs – qui ont déboursé pour être mis en situation historique – sont étrillés par l’un des gardes :
Patrice paie au vendeur deux bouteilles d’eau et des chips. Une sentinelle se jette sur lui, le frappe au visage de sa matraque et lui confisque la marchandise. Elle fait dégager illico presto le vendeur, qui déguerpit. Un renfort de soldats vient se charger de ceux qui se rendaient dans le hall de la gare. J’abandonne nos valises à roulettes et me lance au secours de mon mari, mais un gradé s’en mêle.[16]
 L’héroïne narratrice est absolument débordée par la situation. Que des sentinelles surveillent les touristes et se servent de leur fusil, cela semble, en effet, dépasser les bornes ce qu’elle remarque outrée : « Nous violenter, nous menacer de leurs armes, mais pour qui ils se prennent. Ils vont entendre parler de moi, je ne vais pas en rester là »[17]. Remontrances que n’ont pas les voyageurs de Rykner tout en souffrant cruellement de la même absence d’eau.
L’héroïne narratrice est absolument débordée par la situation. Que des sentinelles surveillent les touristes et se servent de leur fusil, cela semble, en effet, dépasser les bornes ce qu’elle remarque outrée : « Nous violenter, nous menacer de leurs armes, mais pour qui ils se prennent. Ils vont entendre parler de moi, je ne vais pas en rester là »[17]. Remontrances que n’ont pas les voyageurs de Rykner tout en souffrant cruellement de la même absence d’eau.
Les excursions organisées dans les banlieues pauvres existent bel et bien – plusieurs opérateurs ont pris d’assaut le créneau –, toutefois, les agences de tourisme, si elles proposent bien à l’heure actuelle la visite des camps, n’ont pas encore eu l’idée d’y amener leurs clients en wagon à bestiaux. Cela ne saurait probablement plus vraiment tarder. Iront-elles jusqu’à les faire frapper par la crosse des fusils de sentinelles de pacotilles et avancer nus dans les chambres à gaz pour faire plus authentique ? Chris Simon l’a fait et elle pose la question : « Quel genre d’humains sommes-nous ? »[18]
Chez Simon, tout comme chez Rykner, l’humour est absent de la fiction. L’horreur est non seulement dans les deux romans, mais aussi dans le fait qu’elle continue à se propager sur terre. C’est un peu la faiblesse de la fin du livre de Simon qui annonce : « Plus jamais. Plus jamais ça. »[19], tandis que le lecteur sait avec amertume que « ça » se déroule quelque part dans le monde au moment même où il lit la phrase bien que fréquemment sur un autre continent. Pas les chambres à gaz, non ; mais les massacres, oui. Oui, les massacres se déploient aujourd’hui encore couramment dans la plus grande indifférence.
Devoir de mémoire ou exploitation d’un sujet porteur ?
Une question qui revient incessamment ces dernières années. Depuis le succès planétaire de Jonathan Littell et Les Bienveillantes[20], des auteurs semblent se vouer à la représentation du Mal dans leurs écrits – lorsqu’il ne s’agit pas purement de sa banalisation. L’Origine de la violence de Fabrice Humbert[21], HHhH de Laurent Binet[22], Jan Karski de Jannick Haenel[23] – pour ne nommer que ceux-là parmi tant d’autres – en sont un exemple. Ils sont parfois difficiles à terminer tant ils apostrophent le lecteur et le poursuivent dans ses retranchements douillets à l’abri de son chez-soi. Néanmoins, il en conviendra sans peine : « Il n’y a pas de limite au pire »[24] pourrait bien être la conclusion de tout ouvrage se hasardant dans les terrains marécageux du Mal.
[1] Lydie Salvayre, Les belles âmes, Seuil, 2000, coll. Points, p. 94.
[2] Les belles âmes, op. cit.
[3] Arnaud Rykner, Le Wagon, La Brune/Au Rouergue, 2010.
[4] Chris Simon, Memorial Tour, Editions du Réalisme délirant, 2016.
[5] Le Wagon, op. cit., p. 19.
[6] Ibidem, p. 26.
[7] Ibidem, p. 36.
[8] Ibidem, p. 54.
[9] Ibidem, p. 66.
[10] Ibidem, p. 137.
[11] Les belles âmes, op. cit., p. 27.
[12] Ibidem, p. 45.
[13] Ibidem, p. 42.
[14] Memorial Tour, op. cit., p. 38.
[15] Les belles âmes, op. cit., p. 115.
[16] Memorial Tour, op. cit., p. 68.
[17] Ibidem, p. 68.
[18] Ibidem, p. 119.
[19] Ibidem, p. 133.
[20] Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Gallimard, 2006.
[21] Fabrice Humbert, L’Origine de la violence, Le Passage, 2009.
[22] Laurent Binet, HHhH, Grasset, 2010.
[23] Jannick Haenel, Jan Karski, Gallimard, 2009.
[24] Les belles âmes, op.cit., p. 36.
Credits photographiques:
© Mémorial d’Auschwitz-I

