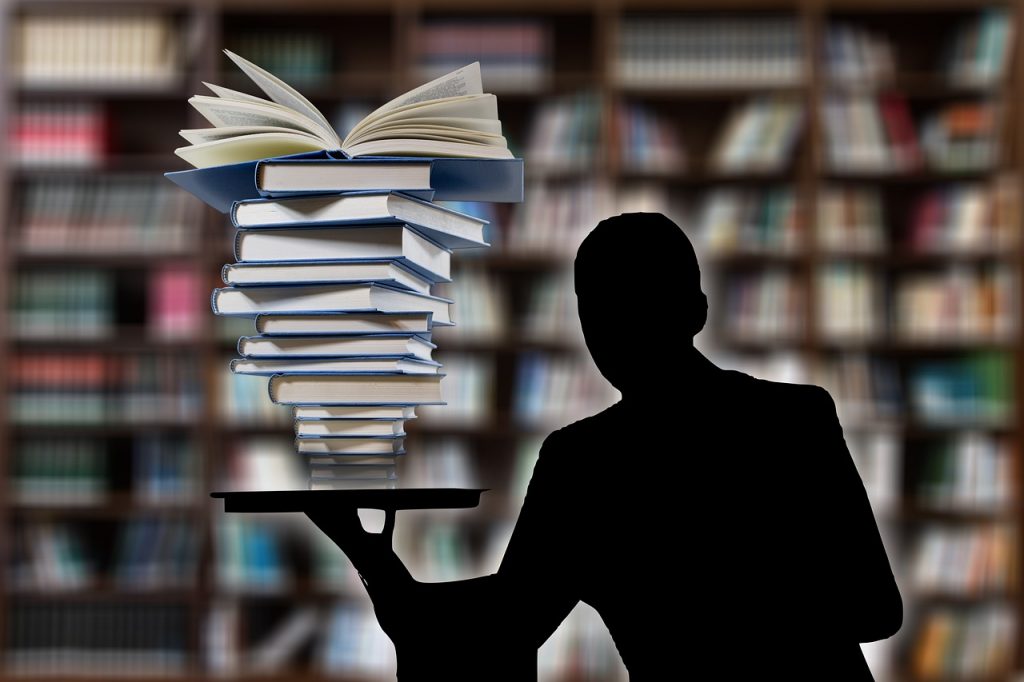On dit souvent que les meilleurs souvenirs se créent autour de la table. Ces souvenirs peuvent souvent être rappelés de manière si vivante car ils stimulent tous les sens : les sons créés lors de la préparation du plat, la sensation des ingrédients, les vues magnifiques des plats colorés et, bien sûr, les odeurs et les goûts sont les stars du spectacle. . La nourriture déclenche souvent des souvenirs et des émotions plus profondes, allant au cœur de nos pensées et de nos sentiments internes.

La nourriture est également souvent au centre de l’attention lors de rassemblements spéciaux, un autre lieu où se créent souvent des souvenirs marquants. Il peut y avoir tellement de traditions autour de la nourriture – pensez aux vacances dans votre maison. Quel rôle la nourriture a-t-elle joué ?
Lorsque nous voyageons dans de nouveaux endroits, l’une des grandes priorités est souvent d’essayer la cuisine locale traditionnelle de la région que nous visitons. Avez-vous des histoires intéressantes (ou peut-être moins géniales) sur la nourriture lors d’un voyage ? En quoi les coutumes et traditions autour de la nourriture diffèrent-elles de celles auxquelles vous êtes habitué ? Y a-t-il des aliments sacrés ou particulièrement spéciaux dont vous avez entendu parler ?

Il peut également y avoir de nombreuses pensées et schémas négatifs concernant la nourriture, ce qui peut être un sujet très déclencheur pour certaines personnes. Si c’est pour vous, explorez ces sentiments si vous vous sentez à l’aise et demandez de l’aide si cela devient trop difficile à gérer par vous-même. Parfois, les histoires les plus difficiles sont celles qui trouvent un écho auprès des gens et nous donnent un plus grand sentiment d’appartenance et d’unité avec nos semblables. Cela peut être très puissant dans un recueil d’essais. En même temps, je ne saurais trop insister sur le fait que même s’il peut être extrêmement thérapeutique de surmonter certaines de ces pensées et émotions, nous ne voulons jamais nous pousser trop loin. A travers ce cours, soyez avant tout bienveillant envers vous-même.

Quelques idées pour stimuler votre écriture :
Avez-vous un plat préféré, un dessert spécial ou une recette préférée ? Où ce plat est-il apparu dans votre vie ? Y a-t-il un fil conducteur ? Pourquoi l’aimes-tu autant ?
Y a-t-il un aliment qui vous ramène immédiatement à votre enfance ? De quoi s’agit-il et qu’est-ce qui le rend si important ?
Quelle est la tradition culinaire de votre famille autour des vacances ? S’agit-il de souvenirs précieux ou de quelque chose que vous souhaiteriez pouvoir oublier ?
Si vous vous sentez inspiré, prenez une journée cette semaine et recréez un plat de votre enfance que vous n’avez pas mangé depuis longtemps. Notez tout ce que vous ressentez pendant que vous préparez, puis dégustez-le.
Racontez-nous l’histoire de votre meilleure (ou pire) expérience culinaire en voyage.
Si vous cuisinez, racontez une histoire sur quelque chose que vous avez préparé pour quelqu’un d’autre. A-t-il été une réussite ou le repas n’a-t-il pas été à la hauteur de vos espérances ?
Avez-vous un restaurant préféré? Dites-nous pourquoi c’est si incroyable.