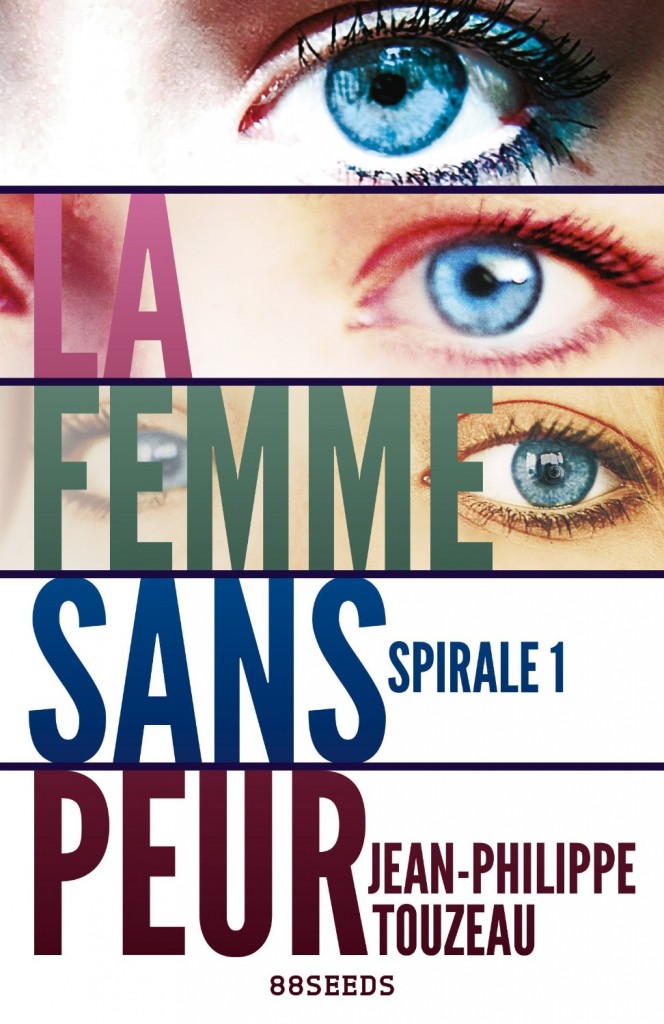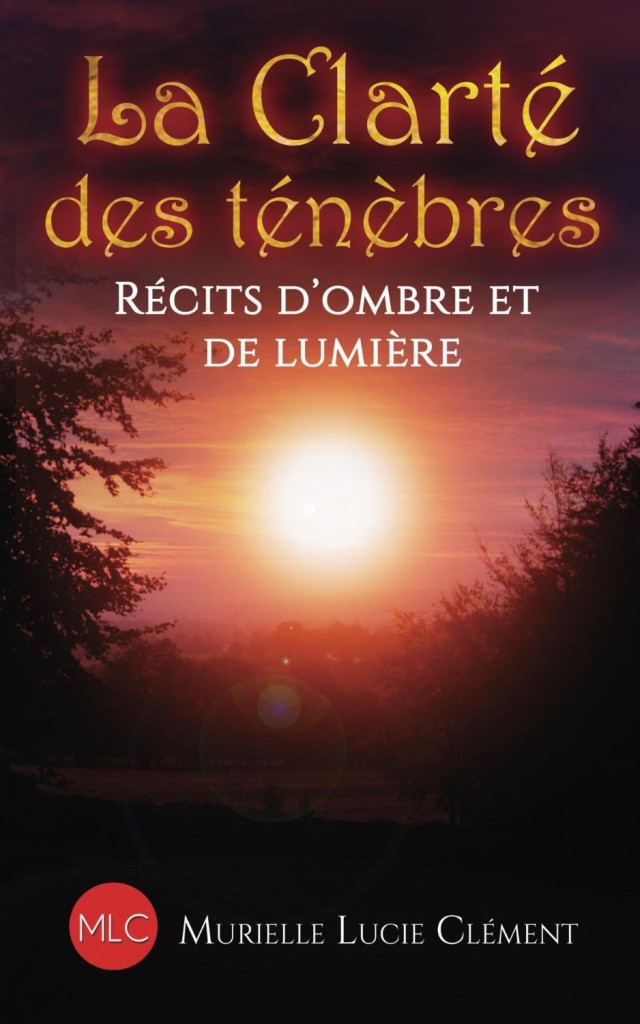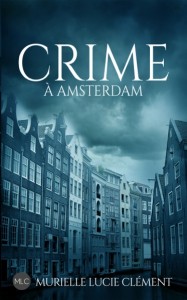 « Au moment où nous passons, enfin la société en général, le plus clair du temps à communiquer sans nous voir, courriel, Facebook, enfin l’Internet, on vient nous seriner que le visage est primordial dans la conversation et le contact comme si les rues étaient remplies de gens souriants et conversant à tour de bras ! Non, mais regardez autour de vous ! C’est paradoxal, cette histoire. Les gens évitent même de croiser leur regard… alors… pour ce qui est de se parler ! C’est cela l’espace urbain !»
« Au moment où nous passons, enfin la société en général, le plus clair du temps à communiquer sans nous voir, courriel, Facebook, enfin l’Internet, on vient nous seriner que le visage est primordial dans la conversation et le contact comme si les rues étaient remplies de gens souriants et conversant à tour de bras ! Non, mais regardez autour de vous ! C’est paradoxal, cette histoire. Les gens évitent même de croiser leur regard… alors… pour ce qui est de se parler ! C’est cela l’espace urbain !»
Jean-Philippe Touzeau, La Femme sans peur – Intégrale 1
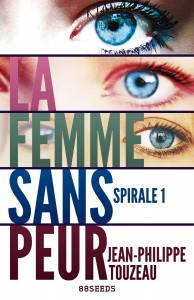 Une rencontre peut tout changer. Jean-Philippe Touzeau le démontre dans son roman-fleuve La Femme sans peur.
Une rencontre peut tout changer. Jean-Philippe Touzeau le démontre dans son roman-fleuve La Femme sans peur.
Qui penserait que Trinity Silverman, une jeune femme brillante, est au dedans d’elle-même tétanisée par ses angoisses ? Cependant, Trinity peine le martyr à chaque épreuve du quotidien. Parler en public est une torture sans nom pour cette conférencière pourtant hors-pair. Un soir, elle fait la connaissance d’un chercheur qui détient la pilule magique qui la délivrera de toutes ses peurs. Selon lui, une seule de ces petites pilules blanches lui procurera aisance et légèreté et lui ôtera ses inhibitions. Trinity accepte le marché proposé et le miracle se produit! Oui, mais pour combien de temps? Qu’importe! Trinity se lance dans l’aventure qui la mènera de pays en pays, ses frayeurs oubliées avec son fidèle petit compagnon Speedy.
Une écriture simple, mais précise emporte le lecteur à la suite de la jeune femme de rebondissement en rebondissements, et lui fait découvrir tout un univers captivant où un petit escargot peut lui en remontrer au sujet de bien des choses. Mais attention, il ne s’agit ici nullement d’héliciculture. Speedy, est un animal de compagnie à l’intelligence raffinée et plein de compassion pour la gente humaine appréhendée par l’odorat.
De toute évidence, Jean-Philippe Touzeau aime rechercher les moindre détails rapporté dans chaque volume avec délices pour la plus grande joie du lecteur. Ce dernier doit croire au merveilleux pour apprécier les péripéties du petit gastéropode à coquille. Une série qui se rapproche des Fourmis de Bernard Werber et laisse le lecteur pénétrer dans un inconnu si peu éloigné du sien pour peu qu’il ose regarder où ses pas le guident.
Jean-Philippe Touzeau, La Femme sans peur – Edition Intégrale sur Amazon
Murielle Lucie Clément: Entretien avec Maximilien Friche de MN
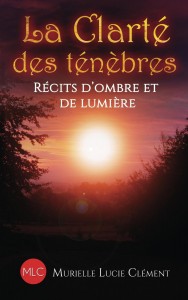 « Avec La Clarté des ténèbres, nous plongeons dans le songe à la suite de Murielle Lucie clément, incapable d’opposer la moindre résistance. Dans ce recueil de nouvelles et de pensées, des visions de l’enfer côtoient la banalité des incivilités du quotidien dans de courts récits qui sont toujours révélations. »
« Avec La Clarté des ténèbres, nous plongeons dans le songe à la suite de Murielle Lucie clément, incapable d’opposer la moindre résistance. Dans ce recueil de nouvelles et de pensées, des visions de l’enfer côtoient la banalité des incivilités du quotidien dans de courts récits qui sont toujours révélations. »
MN a rencontré Murielle Lucie Clément à la suite de la lecture d’un recueil de nouvelles et de pensées intitulé « La Clarté des ténèbres ».
MN : Tout d’abord, je souhaiterais vous questionner sur la forme. Vous êtes romancière et essayiste, et vous avez opté pour une forme concise pour vous exprimer ici : la nouvelle. Une bonne part de ce livre est composée de nouvelles et la dernière partie est consacrée à l’expression de pensées, là aussi sous la forme courte. A votre avis, qu’est ce qui donne sa force à la nouvelle ? Comment parvient-on à créer un monde avec si peu ? De même vos réflexions finales semblent se passer de préliminaires, de discours de la méthode et d’outils de démonstrations, pour simplement dire ce qui est. N’est ce pas aussi simple que cela dans votre recueil : dire ce qui est, dire ce que l’on voit et ne pas attendre de réponses… Il semble d’ailleurs que la nouvelle soit toujours plus achevée qu’un roman, elle ne semble jamais attendre de suite… Qu’en pensez-vous ?
Murielle Lucie Clément : Vous me considérez comme « romancière et essayiste », cela résonne de façon particulièrement intéressante en moi. La date de parution de mes ouvrages ne correspond pas toujours avec leur date de création. J’ai écrit ces petits récits, j’hésite à les appeler nouvelles. Grande admiratrice de Prosper Mérimée, cela me gêne un peu de le faire. Ces récits donc ont été écrits avant les essais et les romans ! Pour être franche, je m’essaie à plusieurs genres : poésie, avec les styles différents (alexandrins, vers libres, sonnets, poèmes en prose etc.), récits, essais, romans etc. Après une formation de cantatrice où on apprend les styles différents si ce n’est à les exécuter du moins à les reconnaître : opéras, lieders, blues, country…, j’estime qu’il doit en être de même pour l’écriture. L’ébahissement me submerge en voyant tous ces gens s’auto nommer écrivains après avoir écrit un livre, en règle générale, un polar (un mot déjà tellement trivial en soi) sans avoir aucune idée de la littérature. Je m’interroge comment font-ils ? Alors oui, pour moi, il est indispensable d’être capable d’écrire des récits concis, des nouvelles si vous y tenez, tout autant qu’un roman ou un essai ou des poèmes, pour qu’ensuite cette faculté, peut-être non pas de choisir, mais de suivre, s’ouvre à nous. Cela est aussi nécessaire en lecture, je pense. J’entendais l’autre jour cette jeune lectrice demander, après son achat des Misérables, si le style soutenu de Victor Hugo n’était pas trop difficile à lire. Amusant, non ?
Maintenant, si on parle de la force de la nouvelle… il y en a des faibles, des insipides, des fastidieuses, des monotones, bref ce sont les exécrables nouvelles (je ne voulais pas employer l’épithète « mauvaises » dans notre entretien en cohabitation avec ce substantif). La concision peut apporter la force comme la faiblesse. Pour parler de ces nouvelles précises contenues dans « La Clarté des ténèbres », elles sont venues telles quelles. Presque impossible de parler de choix, ce sont plutôt des graines venues avec les tempêtes, d’où il sortira peut-être un jour un roman si elles lèvent, si je les arrose et les porte à la lumière dans un bon terreau et que les vents soient favorables. Mais, pour l’instant, elles me paraissaient en leur forme actuelle pouvoir porter cette ombre et cette lumière, équilibre de nos destinées qui, vous avez raison, nous dépassent assurément, mais qui nous survivront, nos destinées continuant leur chemin longtemps après l’arrêt du nôtre. C’est peut-être cela la force des récits courts et des nouvelles. En eux cohabitent tous les aspects de l’univers. Ce sont des gemmes, des pépites à recueillir dans le sable de la route. De légers scintillements. Il suffit de les dire après les avoir vus. Ni question ni réponse ne saurait les ternir et nul n’est besoin ni de l’un ni de l’autre.
Savoir si la nouvelle est toujours plus achevée qu’un roman… certaines le sont incontestablement. Tout dépend vraisemblablement de l’un et de l’autre !
MN : « Cela fait maintenant trente-neuf ans que j’écris mes rêves. » La place du rêve est très importante dans votre ouvrage. De même, que nous ne résistons pas à la lecture de vos nouvelles en plongeant dans l’irrationnel à votre suite, vous semblez ne pas opposer de résistance au rêve, aucune résistance à l’imaginaire qui se démultiplie au fil des pages. On peut ainsi lire que la narratrice est « portée par l’inévitable » ; ailleurs elle dit : « je décide de ne me retrancher dans aucune de mes résistances habituelles »… Et le lecteur accepte de marcher à la suite de la narratrice qui écrit à la suite de ses songes. Entrer en écriture et entrer en lecture procèdent-ils selon vous de cette nécessité de ne pas résister à une force qui nous dépasse ?
MLC : La place du rêve domine une grande partie de ma vie, c’est indubitable. Énormément de rêves visitent mon sommeil et je me souviens d’eux. Grâce à un entrainement quotidien, ils me reviennent au matin. Des centaines de cahiers emplis de mes rêves ! A un moment donné, toute la matinée m’était nécessaire pour les coucher sur papier tant ils étaient nombreux et complexes. Le développement de ma faculté à rêver allait de paire avec mon développement personnel et l’évolution de mon écriture. On néglige trop ses rêves, au propre comme au figuré. Ils nous révèlent tellement si on prend la peine de les lire. Et pourquoi résister ? Il y a cette force immense, cette intelligence en nous qui nous dépasse et nous devons nous laisser emporter pour la surpasser et atteindre le dépassement de soi, le salut. Les rêves apprivoisés représentent une forme de sotériologie. Entrer en écriture ou entrer en lecture procède de ce même processus de se couler en cette force, cette énergie, cet amour inconditionnel que nous portons tous en notre moi et auquel nous tentons trop souvent de résister. Son seul but consiste à nous emmener là où nous désirons aller, ordinairement sans le savoir.
MN : Dans votre façon de décrire à mesure que vous avancez, on a parfois l’impression de découvrir une prophétie. Il y a de l’Apocalypse de Saint Jean dans cette façon de décrire ce que l’on a vu en songe, sans le transformer par une narration plus rationnelle, pour ne rien déformer de ce qui a été reçu. Et vous nous offrez tantôt une vision de l’enfer (C’était en l’an 2000, Les mangeurs de fœtus), tantôt une vision d’un quotidien anodin où la courtoisie est mise à mal (Le déjeuner, Le libraire). Ces visions s’alternent. Un point commun surgit-il néanmoins entre vie ordinaire et vision de l’enfer, et ce point commun n’est-il pas un sentiment de viol ?
MLC : De l’Apocalypse uniquement dans son sens premier de dévoilement, révélation et non dans le sens trahi de catastrophe qu’on lui donne trop souvent de nos jours. Pourquoi tout vouloir toujours transformer ? Ce que nous recevons est si pur même recouvert des scories les plus immondes. « C’était en l’an 2000 » est un songe révélateur transposé au matin à la force de ma plume pour échapper à cette oppression d’impuissance étouffante qui m’enserrait. En revanche, un sentiment d’épouvante m’a submergée avec « Les mangeurs de fœtus ». L’encre coulait de mon cœur, j’avais la poitrine écartelée, en sang ; l’hémoglobine maculait mes draps, je baignais dans un bouillonnement de souillure pure de vie et de mort imperturbables. J’aurais tenté en vain d’en arrêter la rédaction ; il me fallait la subir. Pendant plusieurs mois, il m’a été impossible de relire ce texte, il m’était douloureusement étranger. Puis, je tombais sur Perec « W ou souvenir d’enfance ». Je compris alors la place des Mangeurs de fœtus ; il faisait partie d’autres textes lourds à porter, sans plus. « La Rencontre » fut aussi un rêve difficile à assumer, mais cette fois à cause de son merveilleux, de cette féérie qui me transportait. Elle a duré deux nuits d’affilée. Un pur bonheur. Les écrire, ces rêves, c’est pouvoir les revivre à chaque lecture en dépit de leur évanescence. J’aime mes rêves.
Oui, le quotidien met à mal la courtoisie. Nous en avons tous les jours la preuve. La vision de l’enfer et le manque de courtoisie du quotidien s’enchevêtrent dans une brutalité inouïe. Oui, nous vivons journellement ces agressions les plus pénibles qui parfois culminent en un sentiment de viol le plus élémentaire, le viol de notre être intime, qui s’il n’est pas physique, n’en est pas moins réel. Cela transparaît dans « La Clarté des ténèbres », la narratrice devient incapable de se défendre elle-même dans « Le Libraire ». Les agents de police viennent à la rescousse pour dissiper un malentendu, un reflet de notre société. Notre monde dérive de plus en plus loin du ‘Tirez les premiers, Messieurs les Anglais’, un des sommets légendaires d’affabilité.
Pour plus d’informations sur Murielle Lucie Clément : http://www.muriellelucieclement.com/
« L’Ingénu » de Voltaire – 1767, pas une ride !
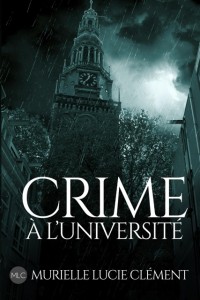 Grand amateur du quartier rouge d’Amsterdam, Bart Verweijden, un des professeurs loufoques de Crime à l’université, prépare son cours sur L’Ingénu de Voltaire :
Grand amateur du quartier rouge d’Amsterdam, Bart Verweijden, un des professeurs loufoques de Crime à l’université, prépare son cours sur L’Ingénu de Voltaire :
« Assis à la table de la cuisine, Bart Verweijden surveillait du coin de l’œil le petit déjeuner de ses deux filles, Nina et Joy. C’était sa semaine de les lever, les habiller, les nourrir et les conduire à l’école. Il avait versé les céréales et le lait dans leur bol et mangeait distraitement une tartine. Il relisait son cours sur Voltaire qu’il allait présenter aux étudiants de seconde année. Il l’avait écrit à la hâte, mais il en était satisfait.
« Cette œuvre de Voltaire évoque, outre la répression contre les Huguenots qui suivit la révocation (1685) de l’Édit de Nantes (1598), la lutte entre les jésuites et les jansénistes qui faisait fureur à l’époque et se répercutera tout au long du siècle. Un point typique, et sans doute l’un des passages clés de ce récit, est la conversion de Gordon à la philosophie par l’Ingénu “… un Huron convertissait un janséniste.” Chapitre 14. Le deuxième point névralgique se trouve certainement dans les conseils d’un jésuite. Ici le père Tout-à-tous gratifie la belle Saint-Yves de son expérience, passage dans lequel Voltaire dépeint l’hypocrisie de l’ordre jésuite et sa sympathie pour les jansénistes (chapitre 16). Dans son ensemble, L’Ingénu est représentatif du siècle des Lumières pour plusieurs raisons. »
Nina et Joy, huit et six ans, regardaient leur père plongé dans sa paperasse. C’était le moment opportun de rajouter du sucre dans leurs céréales sans se faire réprimander. Elles savaient d’expérience que plus rien ne comptait pour lui que sa lecture. Pas question de se disputer et d’attirer son attention. Elles formaient, au contraire, une équipe solide et puisaient l’une après l’autre, cuillérée après cuillérée dans le sucrier. Joy par maladresse, excusable vu son jeune âge, renversa une fournée sur la table ; Nina l’aida tout naturellement à réparer les dégâts et de concert, elles décidèrent que leur bol contenait assez de sucre. Un coup d’œil à leur père les rassura. L’incident lui avait échappé.
« En situant l’action explicitement en l’année 1689 sous le règne de Louis XIV, Voltaire fait comprendre au lecteur de 1767, qui ne peut “ignorer que les jésuites sont expulsés de plusieurs pays d’Europe et aussi de France depuis 1764, alors que les jansénistes occupent des positions influentes dans les parlements et dans l’administration”, que les proscrits d’aujourd’hui peuvent avoir été les persécuteurs d’hier et réciproquement, donc que l’ordre et l’agencement des structures est moins immuable qu’il ne le paraît, que l’homme peut y exercer une influence certaine.
L’Ingénu, la représentation de l’homme sauvage que s’est forgée Voltaire, a, par là même, une fonction didactique, ce qui illustre l’esprit des philosophes qui se voulaient être des enseignants répandant la connaissance. Par les réflexions du héros, les mœurs de Basse-Bretagne d’abord, puis celle de la société ensuite, sont sans cesse comparées à celles de son pays d’origine, le pays des Hurons, le Canada qui serait de loin préférable dans son agencement au pays où il vient de mettre pied, la France. Un trait tout de même intéressant à ce sujet, mais dépassant le propos de notre cours et sur lequel je ne m’étendrai pas outre mesure, consiste en ce que le Huron se révèle être après quelques péripéties oratoires, non pas un sauvage, mais un Breton.
L’Ingénu, le symbole de l’innocence persécutée, représente aussi en essence les campagnes de Voltaire contre les erreurs judiciaires dont Le Traité sur la Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763) et contient les germes de toutes ses œuvres, autant passées que futures. Toutefois, nous pouvons nous demander ce que Voltaire aurait écrit de notre époque de progrès, sur la télévision qui nous abreuve sans discontinuer d’images de guerres, de foyers incendiaires de répression des minorités qui sont malheureusement la réflexion véritable de la situation de beaucoup de pays très près de nous. Là, devant nous, les Ingénus contemporains nous éclairent l’obscurité des charniers, l’horreur des camps concentrationnaires, dont nous étions à même de croire qu’ils avaient disparus à jamais. Et qui prétendra que les livres ne sont plus interdits, que la presse est libre ? Ce ne serait pas monsieur François-Marie Arouet qui lui s’est rendu plusieurs fois indésirable, mais qui jamais n’a pu être accusé de démagogie. »
Nina et Joy s’étaient levées de table et attendaient Bart tout équipées, chaussures lacées et parkas enfilées. Il les félicita et les aida à passer les bretelles de leur sacs à dos. Le trio fin prêt, enfourcha chacun sa bicyclette et s’élança sur le chemin de l’école.
Murielle Lucie Clément, Crime à l’université, Editions MLC, 2015
En versions papier et numérique : http://amzn.to/1nlSmQ8
Crime à Amsterdam, sortie le 21 mars !
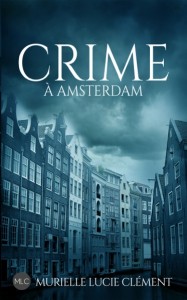 Le quartier du Transvaal à Amsterdam coule des jours heureux. Les habitants ont installé des potagers collectifs où jardiner en famille. Une rue aveugle est égayée par des vitrines ; des fêtes de voisins sont organisées régulièrement. C’est un endroit où il fait bon vivre. Jusqu’au jour où le corps dénudé d’une jeune femme est retrouvé le long du canal. Son meurtrier a tailladé ses chairs pour y imprimer des croix gammées. Les gens choqués peinent à comprendre. Quelques jours plus tard, un autre corps est découvert, lui aussi porte des croix gammées sculptées dans les chairs. Tout porte à croire aux faits d’un sérial killer. Les esprits s’échauffent et s’inquiètent. Est-il un habitant du quartier ? Les crimes sont-ils liés au passé ? Les inspecteurs Hartevelt et Krijger sauront-ils démystifier l’affaire et redonner au Transvaal sa tranquillité ?
Le quartier du Transvaal à Amsterdam coule des jours heureux. Les habitants ont installé des potagers collectifs où jardiner en famille. Une rue aveugle est égayée par des vitrines ; des fêtes de voisins sont organisées régulièrement. C’est un endroit où il fait bon vivre. Jusqu’au jour où le corps dénudé d’une jeune femme est retrouvé le long du canal. Son meurtrier a tailladé ses chairs pour y imprimer des croix gammées. Les gens choqués peinent à comprendre. Quelques jours plus tard, un autre corps est découvert, lui aussi porte des croix gammées sculptées dans les chairs. Tout porte à croire aux faits d’un sérial killer. Les esprits s’échauffent et s’inquiètent. Est-il un habitant du quartier ? Les crimes sont-ils liés au passé ? Les inspecteurs Hartevelt et Krijger sauront-ils démystifier l’affaire et redonner au Transvaal sa tranquillité ?
- « Page précédente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 20
- Page suivante »