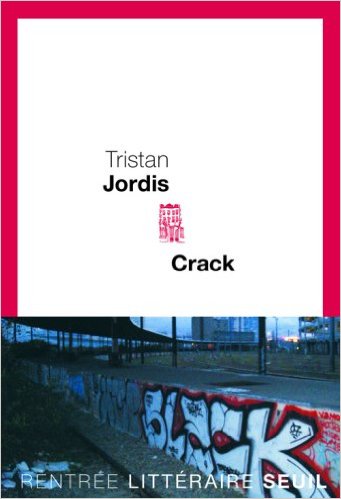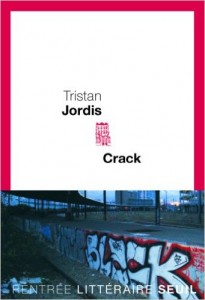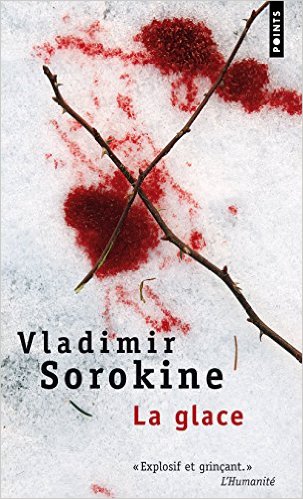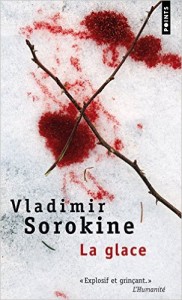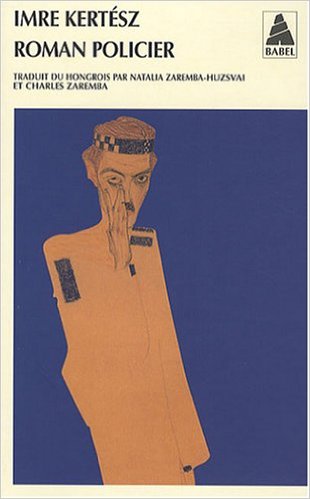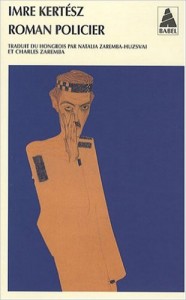Il est très important d’enseigner à un chien son comportement lorsqu’il est jeune. S’il est certes important de jouer et de s’amuser avec votre nouveau chiot ou votre nouveau chien, il est également important d’enseigner à votre compagnon canin ce à quoi on s’attend – les comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas.
Enseigner ces leçons tôt, alors que le chien est encore un chiot, est la meilleure garantie que ces leçons seront apprises et conservées. Les chiens apprennent rapidement et chaque interaction entre un humain et un chien apprend quelque chose au chien. Assurez-vous que vous enseignez les bonnes leçons en tant que maître du chien.
Des techniques de dressage appropriées sont importantes pour la protection du chien ainsi que pour la protection de la famille et de la communauté en général. Alors que les chiens aiment protéger les membres de la famille dans la plupart des cas, un chien mal dressé peut être dangereux et destructeur. S’assurer que votre nouvelle addition à la famille est un plaisir et pas une menace, c’est à vous, en tant que propriétaire que cela revient.
La relation entre les humains et les chiens remonte à plusieurs milliers d’années et les chiens ont été domestiqués plus longtemps que tous les autres animaux. Par conséquent, les humains et les chiens ont développé un lien qui n’est pas partagé par de nombreux autres animaux domestiques. Ce lien fort est très utile lors de la formation d’un chien.
Tous les propriétaires de chiens potentiels et les dresseurs de chiens devraient comprendre le fonctionnement de la société canine en l’absence d’humains. Il est important de comprendre la hiérarchie de la meute et d’utiliser cette hiérarchie à votre avantage lorsque vous entraînez votre chien. Tous les bêtes de groupe ont un animal de tête. Dans le cas des chiens, il s’agit du chien alpha. Tous les autres membres du groupe se tournent vers le chien alpha pour obtenir des directives et des conseils. Le chien alpha, à son tour, joue un rôle de premier plan dans la chasse, la défense contre les prédateurs, la protection du territoire et d’autres compétences vitales pour la survie. Cette disposition de la meute est ce qui a permis aux loups et aux chiens sauvages d’être de tels prédateurs, alors même que d’autres grands prédateurs ont été menacés d’extinction.
Tout cela signifie pour vous, en tant que propriétaire de chiens, que vous devez vous positionner en tant que chef de meute – le chien alpha si vous le souhaitez – afin de gagner le respect et la confiance de votre chien. Si le chien ne vous reconnaît pas comme son supérieur et son chef, vous n’irez pas très loin dans votre programme de dressage.
Le respect n’est pas quelque chose qui peut être forcé. C’est plutôt quelque chose qui est gagné grâce à l’interaction de l’homme et du chien. Au fur et à mesure que le chien apprend à vous respecter et à vous faire confiance, vous commencerez à faire de grands progrès dans votre programme de formation. Un programme de formation fondé sur le respect et la confiance mutuels a beaucoup plus de chances de réussir à long terme qu’un programme fondé sur la peur et l’intimidation.
Un chien craintif est susceptible de devenir un chien mordant à un moment donné, et c’est certainement une chose que vous ne voulez pas dans votre vie. Récompenser le chien quand il fait la bonne chose, au lieu de le punir pour avoir fait la mauvaise chose, est d’une importance vitale pour la réussite de tout programme d’entraînement.
La punition ne fait que dérouter et effrayer davantage le chien, et cela peut détruire un programme d’entraînement de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Il est important de donner au chien la possibilité de faire ce qui est bien ou ce qui ne va pas, et de le récompenser lorsqu’il prend la bonne décision. Par exemple, si le chien poursuit les coureurs, demandez à un ami de courir pendant que vous tenez le chien en laisse. Si le chien tente de chasser le « joggeur », asseyez-le et recommencez. Vous ne punissez pas la mauvaise décision ; vous fournissez simplement le choix. Lorsque le chien est assis calmement à vos côtés, offrez-lui une friandise et de nombreuses louanges. Le chien va vite apprendre que la position assise est le bon choix et que poursuivre le joggeur est le mauvais choix.