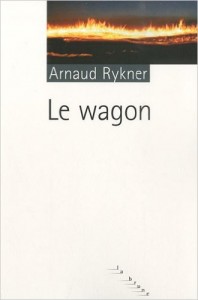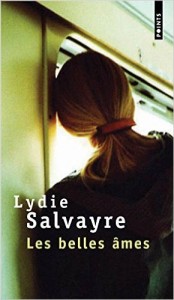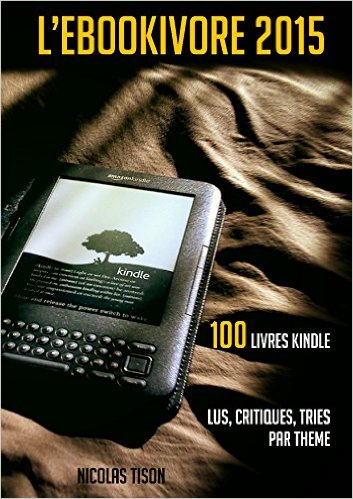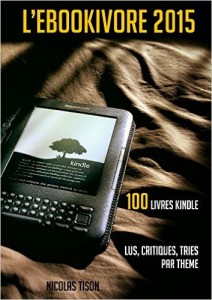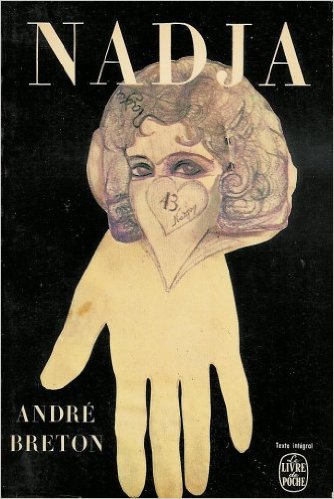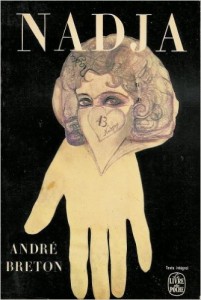“« Nous » et « eux » ou l’image de l’islam chez Fouad Laroui”, dans Ecrivains Maghrebins Francophones et l’Islam : constance dans la diversité, sous la direction de Najib Redouane, Paris, L’Harmattan, 2013.
“« Nous » et « eux » ou l’image de l’islam chez Fouad Laroui”, dans Ecrivains Maghrebins Francophones et l’Islam : constance dans la diversité, sous la direction de Najib Redouane, Paris, L’Harmattan, 2013.
Un écrivain franco-marocain international
Lauréat du prix Goncourt de la nouvelle pour L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine[1], né à Oujda au Maroc oriental, Fouad Laroui étudie au lycée Lyautey de Casablanca, puis à l’École Nationale des Ponts et Chaussées en France. Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur, il repart dans son pays natal et dirige à Khouribga une usine de phosphate. Il passe ensuite plusieurs années à Cambridge et à York où il présente un doctorat en sciences économiques. Il quitte le Royaume-Uni pour les Pays-Bas enseigner l’économétrie et les sciences de l’environnement tout en se consacrant parallèlement à l’écriture. A l’heure actuelle, il fait partie du corps enseignant du Département de français de l’Université d’Amsterdam. De ce qui précède, nous considérons Fouad Laroui un auteur international plutôt que simplement franco-marocain, et cela d’autant plus que ses fictions se déroulent dans divers pays.
Dans cette brève étude, nous nous appliquerons à déceler l’image de l’islam chez Fouad Laroui. Dans ce dessein, après avoir tracé un court portrait de l’auteur, nous nous pencherons sur le « eux » et « nous » et quelques génocides engendrés par cette notion en nous reportant à plusieurs exactions meurtrières. Nous examinerons ensuite la notion de groupe, d’honneur et nous les analyserons ainsi que la présence de la représentation de l’islam dans les fictions.
Dans ses romans, Fouad Laroui plante des personnages loufoques et brosse des portraits comiques de la société comme dans son premier-né, Les Dents du typographe (1996)[2], où un jeune marocain refuse l’ordre établi et se détache de sa patrie ou La Femme la plus riche du Yorshire (2008)[3] qui met en scène des types britanniques et un jeune universitaire qui les étudie avec les mêmes outils d’anthropologue habituellement utilisés pour l’analyse des peuplades dites primitives. Parallèlement à l’humour, ses romans et nouvelles sont riches d’un enseignement qui lui a peut-être été personnellement offert par la vie même.
Le père de Fouad est porté disparu depuis 1969 : « Je suis la dernière personne à l’avoir vu. C’était le 17 avril 1969. Il est sorti de la maison pour aller acheter le journal, et nous ne l’avons plus revu. Je n’en ai jamais parlé à personne, puis quand j’ai commencé à écrire, certains de mes personnages disparaissaient… »[4]. Ses romans, écrits en français, connaissent un grand succès au Maroc. Conjuguant ironie et humanisme, il y dépeint les travers et la pesanteur des relations humaines dans son pays natal ou ailleurs, avec un humour léger et fort à propos. Mais, Fouad peut aussi se montrer sérieux et ses cibles restent la bêtise, la méchanceté et le fanatisme. Comme il le déclare,
J’écris pour dénoncer des situations qui me choquent. Pour dénicher la bêtise sous toutes ses formes. La méchanceté, la cruauté, le fanatisme, la sottise me révulsent. Je suis en train de compléter une trilogie. Les dents du topographe avait pour thème l’identité. De quel amour blesséparle de tolérance. Le troisième qui vient de paraître sous le titre Méfiez-vous des parachutistes, parle de l’individu. Identité, tolérance, respect de l’individu : voilà trois valeurs qui m’intéressent parce qu’elles sont malmenées ou mal comprises dans nos pays du Maghreb et peut-être aussi ailleurs en Afrique et dans les pays arabes[5].
Fouad Laroui est conscient de la disparité entre sa propre personnalité, son expérience existentielle et les membres de la société de son pays natal où il fit l’apprentissage du français depuis son plus jeune âge :
Parce que mon père le voulait ainsi, j’ai effectué toute ma scolarité au sein de la Mission Universitaire Française, ce qui explique pourquoi j’écris en français et non en arabe. Il y a par conséquent une distance, on ne peut pas le nier, entre ce qui est l’arrière-plan de mes romans et moi-même : on peut se demander si le Maroc dont je parle n’est pas une fiction[6].
Et ajoute-t-il dans le même article : « D’ailleurs, cette distance, je la revendique et l’accentue : j’introduis un peu partout de fausses références à un passé auquel rien ne me relie, comme ce philosophe nommé Hamidullah, dans Les Dents du topographe, grande figure à la Ibn Khaldoun, et qui est pur produit de mon imagination »[7]. Les véritables racines littéraires de Fouad Laroui sont peut-être inattendues pour un auteur d’origine marocaine, mais sa scolarité les explique pleinement. Sans être intentionnel, son parcours l’a délibérément porté vers les grands classiques français.
On peut déceler chez chaque auteur des influences diverses, mais il y a généralement, à la base, un Russe pour un Russe ou un Français pour un Français. Des auteurs de prédilection qui ont peut-être arpenté les mêmes rues, fréquenté le même collège, qu’on peut voir dans une hallucination comme un père naturel. En ce qui me concerne, c’est Voltaire, pour l’ironie et le sarcasme, et Diderot pour la liberté et le bonheur d’écrire, et c’est tout […][8].
Toutefois, l’immense érudition de Laroui l’a empêché de négliger les grands auteurs de la culture arabe, en témoignent son essai sur l’islam et ses nombreuses références au Coran et ses sourates, ses détracteurs et ses partisans.
« Eux » et « Nous »
Dans son essai, De l’islamisme. Une réfutation personnelle du totalitarisme religieux (2006), Fouad Laroui établit la différence entre islam et islamisme. Une différence visible dans ses romans et ses nouvelles.
L’islamisme, c’est une vision totalitariste de l’islam, puisqu’il le conçoit comme ayant réponse à tous les problèmes de la vie[9].
Selon Laroui, l’islamisme est plus que l’utilisation politique de l’islam. C’est « la dénaturation d’une foi »[10]. L’exact contraire de cette foi ne repose sur rien, dit-il. La foi est une chose personnelle, un « élan rigoureusement individuel » qui nous propulse au-delà de nous-mêmes, nous pousse à la recherche en dehors de nous-mêmes d’une entité plus grande que nous. Mais, ce sentiment ne peut se définir :
Même un juif rigoureusement athée comme Freud – c’est ainsi qu’il se définissait – mentionne quelque part ce « sentiment océanique » qui s’empare parfois de l’être humain et qui fait plus appel à la poésie qu’à la raison. Sentiment océanique : je fais partie d’un Tout qui me dépasse, que je ne peux saisir par l’exercice de ma pensée. Il me reste à fermer les yeux et à être déraisonnable[11].
Déraisonnable comme le petit Mehdi dans Une année chez les Français (2010) qui s’adonne sans retenue aucune à son amour des mots même s’il ne les comprend pas tous et que ceux-ci le propulsent dans un monde imaginaire inaccessible aux autres.
En ce qui concerne la religion, c’est ce qui définit un « nous » et un « eux » qui génère le « Nous contre eux ». Si selon Laroui, il s’agit-là du problème des décennies prochaines, nous pouvons voir que ce problème existe depuis que le monde est monde et a engendré les pires atrocités.
Toutes ces interdictions, tous ces commandements qui forment le totalitarisme de la vie quotidienne ne servent finalement qu’à définir un nous et un eux. Nous ne mangeons pas de lézard, nous ne nous rasons jamais la barbe, nos femmes sont voilées… [12].
S’il y a encore peu d’études sur les ravages générés par cette division au Maghreb, en revanche des analyses ont été conduites sur d’autres régions. Par exemple, Ben Kiernan, dans Le Génocide au Cambodge[13] a expliqué ce mécanisme d’une vie ordinaire pouvant conduire à des atrocités par le seul pouvoir du « nous » et « eux » en dépeignant dans ses détails la vie de Pol Pot qui, à l’origine, différait peu en un grand nombre de points de n’importe quelle existence de jeunes Cambodgiens partant étudier à l’étranger si ce n’est qu’il connut très peu de la vie villageoise[14].
Génocides
Il est en effet saisissant de voir qu’en moins de quatre années, un quart de la population cambodgienne fut assassinée par l’obsession de la purification déterminée par le « nous » et « eux », la « population de base » et les « autres ». Toute transgression des lois érigées en règlement des moindres détails de la vie quotidienne pouvait entraîner la mort. On peut reprocher à Kiernan une vision naïve du marxisme-léninisme comme l’a fait Jean-Louis Margolin dans sa critique du Génocide au Cambodge[15], cependant, celle-ci n’en est pas moins claire et précise sur les raisons du génocide.
Le génocide, écrivons-nous, est la dimension première du marxisme-léninisme maoïste à la cambodgienne. En effet, partout ailleurs en Asie du Sud-Est, le marxisme-léninisme tenta de récupérer les aspirations nationales à l’indépendance et à la souveraineté par un amalgame nationaliste qui visait à ancrer la révolution dans le cours nécessaire et inéluctable de l’histoire des pays ; or l’idéologie forgée, dans leurs années parisiennes puis après, par Pol Pot et son groupe avait pour principe de restaurer la grandeur historique non plus d’une nation, mais d’une race – la race khmer[16].
Car il faut bien se rendre compte que la notion de « eux » et « nous » fut le déclencheur imperturbable de ce massacre presque continuel :
Cette exaltation de la race est au cœur du régime de Pol Pot, elle dicte sa politique ; elle détermine sa conquête de l’appareil du parti, dès les années 1960, par l’élimination minutieuse de toute la vieille garde communiste cambodgienne formée par le marxisme-léninisme vietnamien du temps des combats antifrançais ; elle est le moteur, à partir de l’intervention américaine, de la politique systématique de prise de contrôle dans toutes les zones, où liquidations et purges font disparaître ceux que l’on juge avoir un esprit vietnamien dans un corps khmer ; elle détermine le processus mis en place dès avant la prise de Phnom Penh d’éradication des minorités nationales non khmères : les Chams musulmans, au premier chef, mais aussi les Vietnamiens, les Chinois et, dans une moindre mesure, les Laotiens et les Thaïlandais ; elle détermine enfin la division de la race khmère entre le peuple de base – paysan, traditionnel, rural, largement illettré, celui des toutes premières zones de maquis créées dès 1970, au lendemain du coup d’État proaméricain de Lon Nol – et le peuple nouveau, celui vidé des villes, urbanisé, éduqué, intellectuel, ouvrier ou commerçant, sensible à l’influence, voire l’éducation et la culture étrangères[17].
Cette haine qui se dilapide sur une autre race, peuple, religion ou parti politique – souvent créés de toutes pièces à partir d’arguments plus ou moins fallacieux – est loin d’être l’apanage d’un peuple en particulier. En effet, l’Ancient Testament présente de nombreuses références à des peuples qui devront être ou seront éradiqués de la surface de la terre et cela toujours en référence à ce fameux « nous » et « eux ».
Quelques exactions meurtrières
Depuis des millénaires, les sociétés humaines ont perpétré des génocides et cela dans toutes les cultures ou presque. Les socio psychologues ont établi que c’étaient des hommes de pouvoir qui en étaient les auteurs. Malheureusement, comme l’a stipulé Douglas M. Kelley dans Twenty-two cells in Nuremberg (1995)[18] ces hommes ne sont pas des fous furieux ou atteints de folie inhumaine – ce que la société préfèrerait croire. Non, en règle générale et prouvée, ce sont des hommes de grande intelligence, en ont témoigné au XXe siècle les dirigeants nazis dont le QI oscillait en moyenne autour de 128.
Des analyses des notes de Kelley et Gilbert, deux psychiatres qui ont conduit, après la défaite du IIIe Reich, des entretiens avec les vingt-deux dirigeants nazis accusés de crimes contre l’humanité, ont déterminé que ces personnes étaient extrêmement bien adaptées et possédaient des personnalités très diverses. En conclusion, il n’y aurait pas de personnalité nazie typique[19]. Et les génocides des Arméniens en Turquie ou des musulmans en Ex-Yougoslavie ou encore de ceux du Rwanda, nous démontrent qu’il n’y a pas de peuple type pour les commettre.
Les expériences et les analyses conduites sur les documents relatifs à l’Holocauste et ses bourreaux devraient nous amener à mieux comprendre les mécanismes des génocides en général. Toutefois, bien que tous les génocides perpétrés au cours des siècles soient tous très différents dans leur exécution et motifs extérieurs, ils ont tous un dénominateur communs : un groupe décide d’en exterminer un autre.
Comme le démontre James Waller dans Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing[20], les groupes qui veulent commettre des crimes de masses – que ceux-ci soient politiques ou sociaux, et que ce soit sur la base de différences ethniques, religieuses ou raciales –, ne sont jamais en manque d’individus pour les exécuter. Seule exigence : forger le fameux « eux et nous ».
Le groupe, l’honneur, l’islam
Le « nous » et « eux » a besoin d’un ou de plusieurs dénominateurs communs pour devenir effectif comme groupe. Selon Laroui, la langue peut créer ce sentiment d’appartenance à un groupe. Dans De quel amour blessé (1998), un des protagonistes démontre à l’autre que pour être arabe, il est nécessaire de comprendre l’arabe : « Oum Kalsoum, c’est la Callas… C’était une cantatrice, une superstar ! Donc : un cheikh huileux, un Libanais de Neuilly ou un footballeur du Maghreb, ce qu’ils ont en commun, c’est de pouvoir écouter Oum Kalsoum en version originale. Or toi, tu ne parles pas arabe, donc tu n’es pas un Arabe. C’est mon point de vue, je ne bouge pas de là » (68). Et en revanche, connaître les mots sans en comprendre la signification n’a aucune valeur (74).
Par ailleurs, Henri Tajfel, un socio psychologue britannique, a enquêté sur les caractéristiques communes nécessaires pour qu’un groupe se considère tel et sa conclusion fut que leur nombre pouvait être infime. Un de ses élèves, Richard Bournis, l’exprime ainsi :
Henri Tajfel, dans ses études originales, a réussi à démontrer que la catégorisation « eux-nous », et aussi l’identification à son propre groupe, est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l’autre groupe[21].
Ainsi peut-il se révéler en temps de guerre, non seulement dans l’armée, mais aussi au travers des genres et engendrer une véritable guerre des sexes comme l’expriment plusieurs analyses de génocides. Par exemple, Gerhard Reichling dans le livre de Helke Sander et Barbara Johr, BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder parle des femmes allemandes violées et souvent tuées par les soldats soviétiques à Berlin[22] et remarque que ces faits sont encore par trop méconnus et parfois sciemment occultés. Par ailleurs, le viol, souvent perpétré en tant que représailles du vainqueur sur le vaincu l’est aussi pour sauver l’honneur du premier, mais détruit celui du second.
Cependant, comme l’exprime Fouad Laroui, combattre avec courage peut être admis bien que d’autres possibilités soient aptes à sauver l’honneur.
Si l’on veut survivre comme individu, la meilleure stratégie dans une bataille, c’est de prendre la fuite. Mais si tout le monde fait cela, c’est la débandade et la fin du clan. L’honneur du membre du clan, c’est donc de combattre et de combattre avec courage. D’autres conduites étaient honorables : l’hospitalité, la dignité, la générosité, etc. Tout cela ne pose aucun problème : ce sont des vertus qui sont également souhaitables chez l’individu dans un monde sans tribus. Le nôtre, par exemple[23].
Les romans, les nouvelles, l’islam et le Coran
Grâce à ses personnages, Laroui détruit quelques préjugés et en débusque d’autres profondément enracinés dans la croyance sociétale comme celui qui fait admettre que tout Arabe est musulman. Ainsi, dans Une année chez les Français, le petit héros Mehdi est-il subjugué par la vie au lycée et par son entremise, Laroui montre que tous les Marocains ne sont pas nécessairement musulmans (142). L’islam n’interdit rien à l’exception de faire sa prière en état d’ébriété, donc l’absorption de vin est autorisée par le Coran, dans une scène où s’accentuent les malentendus. Mehdi grimaçant devant le verre de vin tendu, le pion qui vient de le lui offrir, pense que cela est dû à la pauvre qualité du breuvage : « Ce n’est pas du château pétrus mais ce n’est pas non plus de la piquette » professe-t-il après lui avoir appris que « Les Français, ils mettent du vin dans le biberon de leurs enfants » (143-144). Phrases où perce l’humour de Laroui. Le « château pétrus » réunit le vin tant aimé des Français – il faut tout de même l’avouer, s’il est bon il provient d’un château, d’où son appellation – et petrus, le petit clin d’œil à la chrétienté. Et l’autre côté du cliché, laisse voir les Français qui mettraient du vin dans le biberon de leurs enfants – les préjugés ont la peau dure.
Par les réflexions de Medhi à la fin de l’année scolaire, Laroui démontre l’inanité des préjugés d’un groupe vis-à-vis de l’autre :
Tayeb disait des professeurs de Lyautey que c’étaient des barbares parce que certains vivaient en concubinage […]. Et peut-être y avait-il dans certains comportements, certaines idées de Tayeb quelque chose de barbare aux yeux de… M. Porte, peut-être ? (296)
Le Coran demande à ses adeptes d’être mariés pour être de bons musulmans. Une obligation que Laroui précise dans l’un de ses romans, comme nous le verrons plus loin. Que le Coran interdise les jeux de dames ou d’échecs, le narrateur de Quel amour blessé le réfute (47) et la maîtresse de maison se révolte en refusant d’accomplir les tâches ménagères lorsque l’on veut la priver de télévision qui selon un invité serait un péché (48).
Et comprendre tout le monde signifie quoi pour celui qui comprend l’une et l’autre des positions de chacun ? Être doublement barbare ou être rien du tout ? Deux conclusions « aussi inquiétante » l’une que l’autre pour Medhi au début du chemin de la vie.
Parler de temps en temps de religion implique de parler du Coran lorsque les Marocains sont en scène. Aussi dans Le Jour où Malika ne s’est pas mariée (2009), le lecteur fait-il la connaissance avec le hadith qui stipule l’obligation de se marier pour un bon musulman. Mais, les « bondieuseries laïques » que sont les tours Eiffel en plastique, les filets de pêcheurs accrochés aux murs, les vues du Mont-Saint-Michel, le Gavroche, le poulbot et les réclames diverses apparaissent dans La Femme la plus riche du Yorkshire, sans qu’il soit questions de « eux » ou « nous ».
Chez Laroui, il s’agit plutôt souvent de « moi » et « eux » comme dans La Femme la plus riche du Yorkshire où le « docteur Serghini, fleuron de l’université marocaine » se voit, à son corps défendant et un peu d’amertume, « surveillé par un jongleur déchu qui vit dans une hutte » (51). « Voilà ce que c’est d’être étranger » souligne le narrateur de Laroui. De même dans De quel amour blessé, le protagoniste devient-il conscient d’un mur invisible entre « eux » et lui le jour où « une vieille dame serre tout à coup son sac à main à sa vue » (27). La même scission a lieu lorsque le narrateur observe la politique dans les journaux et les « intégristes démocrates » (44).
Laroui crée aussi des situations où la discrimination est évidente comme dans Tu n’as rien compris à Hassan II(2004) où le professeur Belbal est soumis à un interrogatoire par un journaliste plein de parti pris en tant qu’allochtone alors qu’il « avait participé à la mise au point de la technologie des écrans plats » :
– Comment expliquez-vous que vous, vous vous en soyez sorti ?
L’interpellé ne compris pas tout de suite le sens de cette phrase. Pourquoi ne s’en serait-il pas sorti ? Il n’était pas inscrit dans ses gènes qu’il allait dépouiller les vieilles dames et démolir les aubettes. L’animateur impatient, répéta sa question, sous une autre forme […]. (78)
Mais les préjugés fonctionnent des deux côtés :
Encore aujourd’hui j’ai du mal à me débarrasser de ce préjugé ancré dans mon âme de pitchoune, que les Américains, c’est des gens qui te racontent des histoires pendant une demi-heure puis t’offrent une limonade pour faire passer. (89)
À la veille de Noël, que les enfants souhaitent fêter avec un arbre, la discorde éclate dans la famille arabe où un cousin s’érige contre cette coutume qui devrait être réservée aux chrétiens mais ne pas faire son apparition dans une famille arabe (94). Laroui ne manque cependant pas une occasion d’accentuer les ressemblances entre les différentes communautés en dépit de l’administration qui tente de le faire pour les différences comme écrire sur les fiches d’inscription la différence entre Français (F), Marocains israélites (MI) ou Marocains musulmans (MM), une pratique contre laquelle s’érige les enfants (98) en créant une religion nouvelle (100).
La vieille dame du riad (2011) est certainement le plus politique des romans de Laroui. Là sont aussi plus présentes les citations et références au Coran. Pour se marier, la lecture de la première sourate, la Fatiha est suffisante (104) et un homme peut, selon la chari’a posséder jusqu’à quatre épouses (105). L’islam honore la profession de marchand. Et les paroles du Prophète son reproduites dans les pages du roman (113). Le héros s’interroge : « Ne sommes-nous pas en dar el-islam, maison d’islam, terre pacifiée » (113) et l’Espagne, la France et l’Angleterre, d’où viennent les infidèles « dar el-harb, orbe de guerre » (113).
Et Tayeb, parti à la guerre médite la vingt-septième nuit du Ramadan, la « nuit sacrée » (134). Abdelkrim confessera que le fanatisme religieux fut cause de sa défaite (154) et le seul grand djihad valable est « celui qu’on fait contre soi » (155). Comme l’expérimente celui qui tente d’apprendre l’arabe – lequel se demande-t-il, celui du Coran ? – dans De quel amour blessé (28). Les fous de religion empoisonnent la vie des autres. Voiler les femmes ? Pourquoi ? Il suffirait pour eux de se bander les yeux (43).
Dans La Vieille dame du riad, Laroui mentionne aussi un crime contre l’humanité : « l’emploi à grande échelle d’armes chimiques par l’Espagne contre la population du Rif » pour forcer l’issue de la guerre.
Dans ce roman, les notions du « nous » et « eux », « Nous contre eux » sont les plus fortes et laissent voir les ravages engendrés par de telles positions. Diviser Arabes et Berbères est une abomination insensée – métaphorisation de la division de tous les peuples – aux yeux des Marocains. « Nous savons tout cela, mon cher Tayeb. Ce sont eux qui ne le savent pas » est la réplique qui salue cette loi imposée par les coloniaux (160).
Conclusion
Fouad Laroui, grâce à son immense érudition littéraire, sa grande connaissance de plusieurs domaines scientifiques et sa position existentielle ancrée dans plusieurs cultures, possède la faculté de démontrer les caractéristiques, les préjugés, les clichés ayant cours dans plusieurs sociétés, de pouvoir les ausculter et les représenter et par un regard alternativement centripète et centrifuge. L’islam et le Coran sont parfois présents dans ses romans, mais jamais l’islamisme ou des islamistes car « l’islamiste, lui, n’est pas amusant : en invoquant les droits de Dieu, qui sont par définition absolus et infinis, il annule purement et simplement ceux de l’homme »[24].
Le XXe siècle a été traversé par des conflits meurtriers et tout comme les génocides qui l’ont secoué ont été générés par la notion omniprésente du « nous et eux ». Laroui démontre de façon subtile, mais néanmoins pertinente et efficace, la nocivité de certaines doctrines, préjugés et clichés et que la seule grande bataille valable est celle que l’on mène contre soi. Ses personnages sont légers et amusants et Laroui a choisi l’humour pour enseigner sans toutefois craindre d’être sérieux comme sa narration de la guerre du Rif dans La vieille dame du riad. Par sa contribution à la littérature sous forme d’essais, de romans, de poésie et de nouvelles, Laroui permet aussi de sentir la grande divergence entre islam et islamisme, une différence trop peu accentuée à l’heure actuelle dans notre société surmédiatisée.
BIBLIOGRAPHIE
Bournis, Richard. Radio Canada, consulté le 26 décembre 2011, http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_ 10939.shtml.
Gilbert, Gustave M. Nuremberg Diary, Da Capo Press, 1995.
Kelley, Douglas M. Twenty-two Cells in Nuremberg, M.D. New York, Greenberg Publishers, 1947.
Kiernan, Ben. Le Génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, Paris, Gallimard, traduit de l’anglais par Marie-France de Paloméra, 1998, 730 p.
Laroui, Fouad. « Entretien avec Christine Rousseau », dans Le Monde, 12 mars 2004.
______________. Le Magazine littéraire, avril 1999.
______________. Les Dents du typographe, Paris, Julliard, 1996.
______________. De quel amour blessé, Paris, Julliard, 1998.
______________. Méfiez-vous des parachutistes, Paris, Julliard, 1999.
______________. La Fin tragique de Philomène Tralala, Paris, Julliard, 2003.
______________. Tu n’as rien compris à Hassan II, Paris, Julliard, 2004.
______________. De l’islamisme. Une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, Paris, Éditions Robert Laffont, 2006.
______________. La Femme la plus riche du Yorkshire, Paris, Julliard, 2008.
______________. Le Jour où Malika ne s’est pas mariée, Paris, Julliard, 2009.
______________. Une année chez les Français, Paris, Julliard, 2010.
______________. La vieille dame du riad, Paris, Julliard, 2011.
MARGOLIN, Jean-Louis. « Le Génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir », Paris, Gallimard, traduit de l’anglais par Marie-France de Paloméra, 1998, 730 p., dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, année 1998, numéro 60, pp. 160-161.
Sander, Helke et Johr, Barbara. BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder, Fischer-TB.-Vlg.,Ffm, 1999.
Waller, James. Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing, Oxford University Press, USA, 2005.
Zillmer, Eric, Retzler, A. Barry A., Harrower, Molly et Archer, Robert P. The Quest for Nazi Personality: Psychological Investigation of Nazi War Criminals (Personality & Clinical Psychology), Lawrence Erlbaum Assoc Inc, 1995.
Notes
[1] Fouad Laroui, L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine, Julliard, 2012
[2] Fouad Laroui. Les Dents du typographe, Paris, Julliard, 1996.
[3] Fouad Laroui. La Femme la plus riche du Yorkshire, Paris, Julliard, 2008.
[4] Fouad Laroui. « Entretien avec Christine Rousseau », dans Le Monde, 12 mars 2004.
[5] Fouad Laroui. Le Magazine littéraire, avril 1999. Nous aimerions ajouter : ne le sont-elles pas partout dans le monde à un niveau plus ou moins élevé ?
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Fouad Laroui. Le Magazine littéraire, avril 1999.
[9] Fouad Laroui. De l’islamisme. Une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, Robert Laffont, 2006, p. 155.
[10] Ibid., p. 10.
[11] Ibid., p. 46.
[12] Ibid., p. 172.
[13] Ben Kiernan. Le Génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, Gallimard, 1998, traduit de l’anglais par Marie-France de Paloméra.
[14] Ibid., pp. 18-21.
[15] Jean-Louis Margolin, dans Vingtième siècle. Revue d’histoire, année 1998, numéro 60, pp. 160-161.
[16] Kiernan. Le Génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, pp. 18-21.
[17] Kiernan. Le Génocide au Cambodge, 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir, pp. 18-21.
[18] Cf. Douglas M. Kelley. Twenty-two Cells in Nuremberg, M.D. New York, Greenberg Publishers, 1947 ; Gustave M. Gilbert. Nuremberg Diary, Da Capo Press, 1995.
[19] Eric A. Zillmer, Barry A. Retzler, Molly Harrower, Robert P. Archer. The Quest for Nazi Personality: Psychological Investigation of Nazi War Criminals (Personality & Clinical Psychology), Lawrence Erlbaum Assoc Inc, 1995.
[20] James Waller. Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing, Oxford University Press, USA, 2005.
[21] Richard Bournis, Radio Canada, consulté le 26 décembre 2011, URL : http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_10939.shtml.
[22] Helke Sander et Barbara Johr. BeFreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder, Fischer-TB.-Vlg., Ffm, 1999.
[23] Laroui. De l’islamisme…, p. 139.
[24] Laroui. De l’islamisme, p. 142.