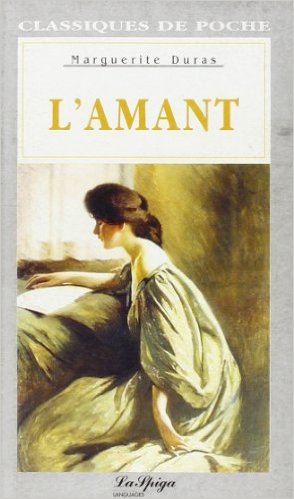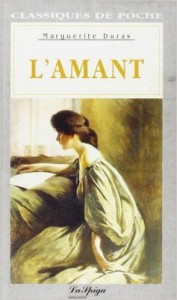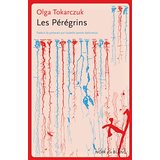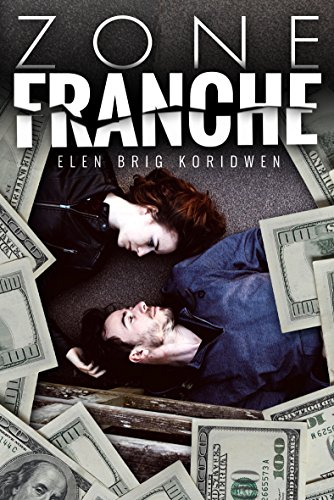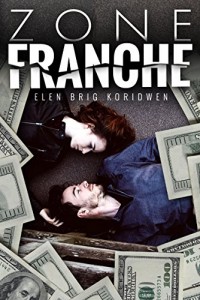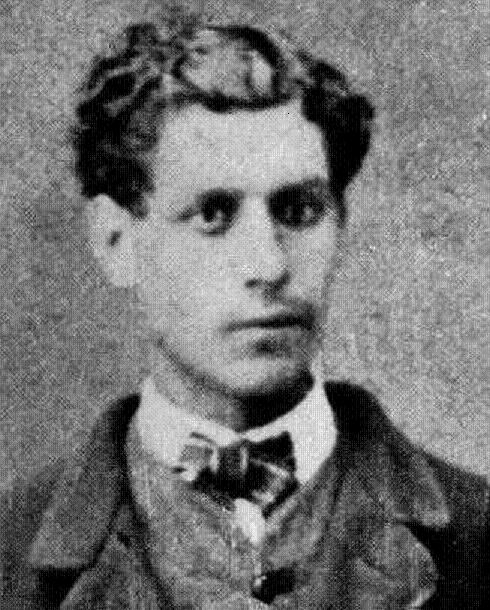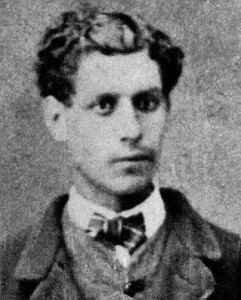Comme le dit Michael Scheningham, la mémoire dans L’Amant est principalement liée au désir d’une manière inextricable. D’autre part, on peut voir dans ce livre que pour Duras la mémoire photographique fait partie de la mémoire autobiographique. L’auteur va jusqu’à penser, inventer pourrait-on presque dire, une photographie qui aurait pu exister et qu’elle place au début du récit pour souligner l’importance de la traversée sur le bac. La mémoire est autoréférentielle et surtout liée à l’écriture car Duras se rappelle les souvenirs qu’elle a couchés sur le papier ce qui leur confère l’authenticité. Le fait qu’ils soient écrits est plus important que de savoir s’ils ont véritablement eu lieu. Ils sont écrits et cela leur donne une existence réelle. Pour Duras, la mémoire passe par l’écriture.
La focalisation
Duras change plusieurs fois de perspective au cours de son livre et très souvent à un moment où le lecteur s’y attend le moins. Par exemple, dans la première scène d’amour avec l’amant, elle passe du pronom personnel de la première personne au substantif (l’enfant) ce qui produit une distanciation. Le « je » est la proximité et le substantif la distance. Sans cesse un changement de focalisation a lieu quelquefois dans les moments les plus intimes, comme si la narratrice n’était pas impliquée. En fait, c’est un style qui cherche à cerner le point crucial (jouissance, désir, mort) qui sont des thèmes Durassiens.
Quelques personnages
La mendiante se retrouve dans plusieurs livres de Duras : Un barrage contre le Pacifique et dans Le Vice-Consul. Une particularité de la mendiante est sa folie, elle a un comportement déviant qui suscite une certaine angoisse. La mendiante est en quelque sorte un alter ego de la mère en cela que cette dernière est également folle et inspire à l’enfant une peur. Bien que la situation de la mendiante diffère de celle de la mère, elles vivent toutes les deux en marge de la société coloniale. La mère et la mendiante sont toutes les deux incapables de s’occuper de leurs enfants d’une manière adéquate.
Hélène Lagonnelle est le seul lien de la jeune fille avec la société blanche des tropiques, elle est la seule qui lui parle car on tient la jeune fille à l’écart. Les « demoiselles de bonne famille » ne doivent avoir aucun contact avec la « petite prostituée blanche du poste de Sadec » qu’elle est devenue. Cependant, en Hélène Lagonelle, elle a une amie qu’elle aimerait faire profiter de son expérience en voulant lui céder l’amant chinois. Elle voudrait qu’Hélène puisse faire l’amour avec le Chinois et connaître comme elle le désir. Le fait qu’elle aimerait alors regarder est moins un acte de perversité que d’amitié.
Les mythes
Si on pense à un mythe de la Bible, c’est bien sûr à Eve et Adam et le fruit défendu. La transgression de l’interdit qui est très fort dans L’Amant : l’interdit pour une jeune fille de faire l’amour avant d’être mariée, l’interdit racial, il s’agit d’une jeune fille blanche ayant des rapports sexuels avec un Chinois et aussi le fait qu’elle accepte de l’argent de cet homme ce qui donne une forte connotation de prostitution à leurs relations. On peut aussi voir le mythe d’Orphée si on garde la traversée du Mékong comme un passage initiatique, auquel cas la jeune fille est Orphée. Elle regarde de trop près le désir en la personne du Chinois, une métaphore d’Eurydice, et finalement elle doit partir seule et laisser le Chinois derrière elle, prisonnier de la ségrégation raciale ou l’enfer. Caïn et Abel pourraient représenter les deux frères. On peut aussi voir le mythe de Médéa en la mère, qui sacrifie ses enfants à son opiniâtreté. Ulysse aussi qui fait un grand voyage d’initiation, Iphigénie et Oreste. Des bribes de mythes surgissent en beaucoup d’endroits. Comme tous les mythes, on ne sait où ils commencent ni vraiment d’où ils proviennent ! En utilisant des substantifs, la mère, la jeune fille, l’enfant, le petit frère et d’autres, Marguerite Duras crée une structure mythique avec une sorte de Lolita, séductrice. Quoi qu’il en soit, Marguerite Duras écrit une histoire universelle, transcendant la réalité banale d’une situation quotidienne. C’est une sorte de circuit que l’on retrouve dans son œuvre, un circuit qui prime sur la réalité extérieure à l’écriture.
Le thème de l’eau
L’eau joue un très grand rôle dans cette structure mythique. Tout d’abord, bien sûr, la traversée du Mékong et ensuite le paquebot qui l’emmènera en France, qui vogue sur l’eau et la mousson qui éclate. A chaque passage important, le rite de passage, on retrouve l’eau. Les amants se douchent longuement comme pour se purifier du monde extérieur et se retrouver dans la pureté de l’innocence de l’amour qui les unit, même si la jeune fille n’est pas vraiment certaine de ses sentiments, ceux du Chinois sont clairs. La maison aussi qui est lavée à grande eau chaque fois que le grand frère est absent, comme pour la purifiée de sa présence par trop démoniaque.
La narratrice et sa mère
L’attitude de la narratrice envers la mère oscille entre l’amour et la haine, amour et dégoût. On retrouve dans cette relation tous les éléments d’une symbiose où l’enfant, bien qu’il y aspire, ne peut encore se détacher complètement de la figure maternelle. Un problème de communication qui se traduit par une crise du langage. Les personnages, non seulement la mère et l’enfant, mais aussi les frères se ressemblent. Cependant, la mère n’a jamais connu la jouissance, elle en est malgré tout curieuse ce qui explique aussi en partie la tension et l’ambivalence de la relation entre l’enfant et la mère.
Le pacte autobiographique
A sa parution, L’Amant a été tout de suite relié à la vie de l’auteur et Duras elle-même en a souligné l’aspect autobiographique. Au début du livre, la narratrice dit explicitement « Il faut que je vous dise encore, j’ai quinze ans et demie ». Elle écrit cette phrase dans l’oralité de l’écriture, nous faisant par la même occasion remarquer que son visage est ravagé par l’alcool. Nous savons que Marguerite Duras avait une grande attraction pour l’alcool et aussi qu’elle a vécu sa première jeunesse aux colonies. Ces faits sont pour nous une raison de regarder ce texte comme un récit autobiographique. Mais l’œuvre entière de Duras contient des renvois auto textuels, ce qui n’est pas une qualité exclusive du genre autobiographique comme le souligne Jeannette M. L. den Toonder. Elle nous dit encore que cette manière de procéder montre que Duras aspire à effacer les limites entre les genres. Il y a le moment de la découverte de la vocation qui surtout nous incite à voir le pacte autobiographique dans ce livre. Au moment où la petite fille découvre l’amour, elle sait avec certitude qu’elle veut écrire. C’est par et à travers l’écriture qu’elle découvre et cherche son identité. L’écriture en tant que telle est vitale. Elle désamorce le langage courant pour atteindre la profondeur. Duras recherche la vérité, elle veut saisir l’insaisissable, cette réalité psychique enfouie au plus profond d’elle-même.
Rite de passage
Le rite de passage ou l’initiation est une aventure mystique. Pour vivre cette aventure, cette initiation, l’isolation de l’individu est d’importance capitale. L’auteur réfère à l’isolation de l’enfant dans cette société coloniale où elle est mise au ban de la société, déjà avant d’avoir vécu son aventure amoureuse. C’est parce qu’elle est isolée qu’elle peut la vivre. Entourée par sa famille et la société, l’expériment n’aurait pu lui arriver. Dans l’initiation, ce rituel anthropologique, l’eau joue un très grand rôle tout comme dans ce récit. Principalement dans les scènes où les amants se douchent pour se purifier du monde extérieur avant de s’unir. La narratrice est curieuse du rituel, elle va de l’avant. Cette aventure fait partie de sa quête d’identité. Elle se découvre en performant cet acte sexuel puisqu’elle sait alors ce qu’elle veut. Elle analyse ses sentiments, la situation, le décor, son partenaire, son désir et elle apprend à se distancier tout à la fois. Elle ressort encore plus pure de cette expérience. La souillure de la prostitution ne l’atteint pas. Cela ne fait pas partie de son monde à elle qui est au-delà des apparences comme les voit la société coloniale. Son monde, c’est l’invisible, l’ineffable, le désir omniprésent sans que l’on puisse le décrire, ni l’écrire, ni le créer. Tout comme l’esprit comparable au morceau de sucre immergé dans une tasse d’eau. L’eau devient sucrée et le sucre a disparu. Pourtant sa présence est indéniable. Le goût de l’eau l’authentifie. L’écriture authentifie le désir chez Duras ainsi que sa quête d’identité présente sous et dans chaque parole, chaque mot, chaque lettre écrits.
L’accoutrement symbolique
Peut-être devons nous rechercher la signification de l’accoutrement dans le voyage initiatique lié à l’expérience de la jeune fille. En effet, avant son départ pour la quête initiatique le novice reçoit des habits spéciaux qui l’accompagneront dans son voyage et lui permettront d’être reconnu comme tel par ceux qu’il rencontrera. Que l’on pense aux robes blanches des mariées qui commenceront une vie nouvelle au lendemain de leurs noces ou celles des petites communiantes dans l’église catholique ! Mais aussi, par exemple, aux plumes d’oiseaux réservées à cet effet de différentiation chez les Dogons ou certains peuples de l’Amazonie. L’enfant porte un chapeau comme aucune femme n’en porte en Indochine. Duras met l’accent sur le chapeau et les chaussures. Deux objets fétichistes de l’habillement de la femme et non pas d’une jeune fille de quinze ans à l’époque. L’enfant est vouée à un sort unique, divergeant totalement de celui des autres femmes de son environnement. Ces dernières sont promises au mariage, à l’ennui, au malaise, à la mort, à l’absence de désir ou du moins de sa satisfaction, à l’abandon souvent. Un sort totalement dissemblable attend l’enfant. Son accoutrement la différentie de toutes les autres femmes. Elle est choisie. L’élue sacrifiée renaîtra purifiée, libérée des interdits et des tabous de cette société.
Marguerite Duras, L ‘Amant, Editions de Minuit, prix Goncourt 1984