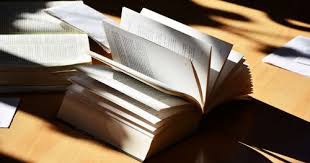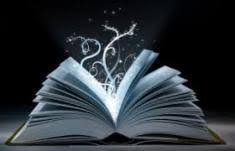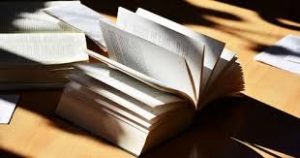 Les personnages sont des êtres fictifs inventés par l’auteur. Ils existent dans le roman, mais aussi dans les films ou les pièces de théâtre. La notion de personnage a évolué au fil du temps. Les personnages d’un roman sont majeurs ou mineurs. On les appelle principaux ou secondaires. Cela dépend du rôle qu’ils jouent dans l’intrigue.
Les personnages sont des êtres fictifs inventés par l’auteur. Ils existent dans le roman, mais aussi dans les films ou les pièces de théâtre. La notion de personnage a évolué au fil du temps. Les personnages d’un roman sont majeurs ou mineurs. On les appelle principaux ou secondaires. Cela dépend du rôle qu’ils jouent dans l’intrigue.
Les personnages principaux :
Ces personnages, les plus importants du roman, sont décrits en profondeur et autour d’eux tourne l’intrigue. Leur développement psychologique est important et ils subissent le plus de transformations au cours de l’histoire ou ils contribuent activement au changement d’un autre personnage principal. C’est avec La Princesse de Clèvesque l’héroïne s’épaissit d’une dimension psychologique.
Les deux personnages principaux dans la fiction sont le protagoniste et l’antagoniste. Dans le polar, ce sera, par exemple, le tueur en série et l’enquêteur qui le traque. Dans une romance, ce sera le héros et l’héroïne, qui ne resteront pas nécessairement sur un pied d’antagonisme.
Les personnages secondaires :
Ces personnages n’ont pas la même profondeur que les personnages principaux. En règle générale, ils sont statiques et ne changent pas beaucoup ou pas du tout au cours de l’histoire. Idéalement, ils créent les circonstances du développement psychologique et de la transformation d’un personnage principal.
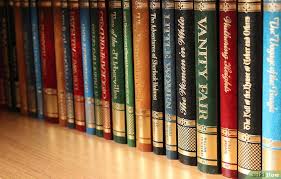 Les différents types de personnages
Les différents types de personnages
* Les mentors : les personnages qui enseignent ou entraînent le personnage principal.
* Les excentriques : des personnages qui suivent leurs propres règles
contraire aux attentes de la société (ex: un millionnaire avare,
celui qui porte des chandails en été). Ces personnages sont fréquemment attachants par une excentricité qui les rend vulnérables et inaptes à vivre en société.
* Les personnages modèles : qui servent à l’auteur à définir un type de société.
* Les personnages clichés : les personnages aux caractères stéréotypés
comme le méchant psychotique, la belle-mère malfaisante, que tout auteur essaie d’éviter. Toutefois, ils sont utilisables lorsqu’ils représentent une valeur, un conflit, ou un fil thématique. Dans ce cas, on leur donne un caractère typique.
* Les petits personnages : des suspects, des collègues, des voisins, des personnes
dans la rue, etc. Ils peuvent aussi avoir une bizarrerie spéciale ou un attribut pour les rendre intéressants. Le but principal de leur utilisation est de créer un univers crédible.
* Les psychopathes : ils semblent normaux à leur entourage, mais le lecteur sait tout de suite qu’ils ne le sont pas.
* Les personnages sacrificiels : ils sont tués pendant l’histoire ou bien avant. Par exemple, la victime dans le polar.
* Les personnages mémorables : ils ont au moins un trait de caractère dont on se rappelle ou bien ils performent une action sortant de l’ordinaire.
* Les personnages phobiques : des personnages avec une peur persistante et irrationnelle d’une chose ou d’une situation spécifique qui les gêne dans la réalisation de leur vie quotidienne.
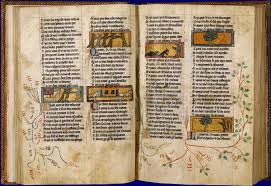 Les fonctions des personnages
Les fonctions des personnages
* L’allié : Celui à qui le protagoniste demande de l’aide et qui la lui donne.
* Le faux allié : Le protagoniste croit que c’est un allié, mais il ne s’occupe que de ses propres intérêts.
* L’adversaire : il veut empêcher l’héroïne ou le héros d’atteindre son but
* Le faux adversaire : il semble travailler contre le protagoniste mais en réalité il est de son côté. Le lecteur croit qu’il est un adversaire mais ses actions font gagner le héros.
* Les révélateurs : des personnages qui révèlent les secrets des personnages principaux ; peut également faire des observations ou prédire comment un personnage majeur peut agir en fonction de l’histoire.
* Les personnages sacrificiels : montrent souvent la force du protagoniste, les enjeux de la situation, ou pour prévenir une information critique d’être révélée.
* Les petits personnages : ils sont là dans le but principal de créer une histoire crédible dans un univers possible.
* Le personnage miroir : reflète le protagoniste ou en montre une image inversée. Il commence dans une situation similaire, puis montre les effets positifs ou négatifs d’une certaine ligne de conduite
* Les testeurs : des personnages qui œuvrent sur les personnages principaux, habituellement, pour les inciter à agir d’une certaine manière. Il peut avoir des points de vue opposés – avec qui le personnage majeur s’alignera-t-il ?
* Le personnage accompagnateur : souligne les traits d’un autre personnage. Il sert souvent à faire ressortir la brillance, les défauts ou la croissance d’un autre personnage. Par exemple, Sancho Pança dans Don Quichotte.
* Le narrateur : fait des commentaires sur l’action et donne au lecteur des informations. Le narrateur ne doit pas être confondu avec l’auteur. C’est l’entité entre l’auteur et ses personnages.